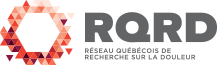Biographie
Gabrielle Pagé détient un doctorat en psychologie clinique. Elle est chercheure boursier junior 1 des Fonds de recherche en santé - Québec et professeure sous octroi adjointe au Département d'anesthésiologie et médecine de la douleur de l'Université de Montréal. Elle pratique comme psychologue à l'Unité de gestion de la douleur Alan Edwards à l'Hôpital général de Montréal.
Ses intérêts de recherche incluent la transition de la douleur aiguë à persistante, les déterminants biopsychosociaux du développement et maintenance de la douleur persistante, l'impact des comorbidités physiques et mentales sur l'expérience et la gestion de la douleur, l'association entre l'expérience de stress et la douleur, ainsi que les trajectoires de soins. Ses études sont principalement épidémiologiques et en contexte de vie réelle.